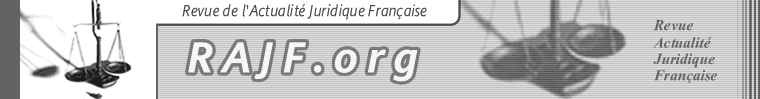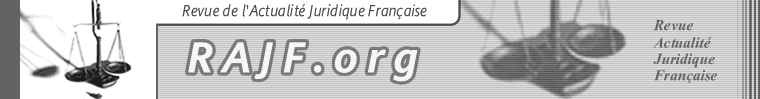L’actualité internationale,
notamment française, a fait de nouveau ressurgir la question des
sectes. La publication d’un rapport parlementaire a mis en exergue les
moyens de financement mis en place par ces groupements ; en outre, la Cour
de Cassation a rendu, le 1er juillet 1999, une décision sur le pourvoi
formé contre la décision de la Cour d’Appel de Lyon dans
l’affaire de l’Eglise de Scientologie, décisions dans lesquelles
les juges ont considéré que le qualificatif de religion pouvait
être donné à ce mouvement. C’est pourquoi, l’équipe
de Jurisweb a tenu à approfondir ces points avec Florence Lacroix,
spécialiste des mouvements sectaires qui a bien voulu répondre
à nos quelques questions.
Florence Lacroix est actuellement
Chercheur en Science Politiques à l’Université de Paris I
 Sorbonne et s’apprête à publier sa thèse qui traite
sous un angle interdisciplinaire (sociologie, histoire, psychiatrie, droit,
géopolitique) de la Soka Gakkai, première secte mondiale
aussi bien en nombre de fidèles et qu’en ressources financières.
Sorbonne et s’apprête à publier sa thèse qui traite
sous un angle interdisciplinaire (sociologie, histoire, psychiatrie, droit,
géopolitique) de la Soka Gakkai, première secte mondiale
aussi bien en nombre de fidèles et qu’en ressources financières.
Propos recueillis par Benoit
Tabaka, Rédacteur en chef de Jurisweb.
Benoit Tabaka : Votre
étude principale porte sur la Soka Gakkai qui est fortement implantée
au Japon. Pouvez-vous nous dresser un aperçu du paysage juridico-religieux
japonais ? Quelle est la nature juridique de la Soka Gakkai ?
Florence Lacroix :
Il n’existe pas vraiment de conceptualisation du phénomène
sectaire au Japon. Ce qui se traduit par un flou dans les termes employés.
Chaque temple ayant le droit de créer sa propre structure (par un
système d’autorisation individuelle délivrée par les
préfectures) et les écoles classiques s’étant scindées
en de multiples courants, on compte entre 180 et 200 000 sectes ou organisations
cultuelles au Japon, dont 1000 à 2000 sectes au sens français
du terme. Lorsqu’on veut stigmatiser les sectes dangereuses, on emploie
le mot étranger "cult".
Pour ce qui est des grosses
sectes, il faut une autorisation délivrée, non par la préfecture,
mais par une agence gouvernementale, le Bunkachô. Or longtemps,
la Soka Gakkai a été enregistrée à la préfecture
de Tokyo, mais depuis l’attentat au sarin perpétré par la
secte Aum Shinrikyô, les grosses sectes doivent être enregistrées
au Bunkachô et la Saka Gakkai étant la plus grosse secte
nippone, elle doit désormais être enregistrée au Bunkachô.
Aux termes de la loi japonaise
sur les "shûkyô dantai", c’est-à-dire les organisations
cultuelles et religieuses, il faut la réunion des 3 conditions pour
obtenir ce statut : une doctrine propre, des lieux sacrés propres,
et des objets de culte propres à l’organisation candidate.
Or, la Soka Gakkai a été
créée dans les années 30 comme branche laïque
de la Nichiren Shoshu (école bouddhique remontant au XIIIème
siècle et créée par le moine Nichiren 1222-1282).
Elle a peu à peu dépossédé cette école
bouddhique de sa doctrine, qu’elle a politisée à l’extrême,
de ses lieux sacrés, de son objet de culte principal - le " Gohonzon"-
qui a subi une dérive commerciale incompatible avec sa nature religieuse.
Autrement dit, on peut dire que la Soka Gakkai ne réunit aucune
des 3 conditions requises pour se voir reconnaître le statut de "shûkyo
dantai", a fortiori depuis le divorce officiel entre les deux organisations
dans les années 90. Ces 2 organisations étant désormais
des entités juridiques distinctes, la Soka Gakkai ne peut plus prétendre
détenir ni doctrine propre,ni lieu sacré (celui qu’elle avait
fait édifier dans l’enceinte du temple Taisekiji ayant été
démoli par la Nichiren Shoshu récemment), ni objet de culte.
Plusieurs observateurs, relayés par des associations,s’appuyant
sur ce constat, ont réclamé la suppression du statut de "shûkyô
dantai" pour la Soka Gakkai. Cette suppression, qui semble évidente
intellectuellement et juridiquement, se heurte à la toute puissance
de la Soka Gakkai, d’autant que le parti politique de celle-ci, le Kômeitô,
va entrer au gouvernement,incessamment sous peu.
La Soka Gakkai ne réunit
donc pas les critères classiques d’une "shûkyô dantai",mais
en plus , elle présente certaines caractéristiques typiquement
sectaires que je me contenterai d’énumérer.
- une structure pyramidale,
avec une bureaucratisation et une multitude de structures qui renforcent
le pouvoir du gourou depuis les années 60, M. Ikeda (il faut noter
qu’il n’est plus le président nominal de la secte, mais détient
de facto le pouvoir réel au sein de la secte).
- une pression financière
extrêmement forte sur les adeptes nippons . A l’étranger,
la pression est moins forte car la consigne est de gagner une bonne image
de marque et de toute façon, avec 8 millions d’adeptes nippons pressurés
régulièrement, ils n’ont pas vraiment besoin d’argent. On
peut dire que les adeptes nippons financent l’internationalisation de la
secte.
- des mécanismes d’emprise
sur les adeptes, avec une déréalisation, la construction
d’un "isolat culturel" (expression empruntée à "la
dérive sectaire" d’Anne Fournier et de Michel Monroi ,PUF), une
dépendance totale provoquée et entretenue par des procédés
de mobilisation psychologique et par un contrôle de l’espace-temps
des adeptes. Une modification de l’éthique et une altération
de l’identité des adeptes, à leur insu.
- une doctrine pseudo-religieuse
( manipulation,et dévoiemen,t de concepts religieux à
des fins de pouvoir)qui légitime les activités politiques
de la secte, car les objectifs de M. Ikeda et de la Soka Gakkai sont d’ordre
purement politique. Il s’agit de devenir le centre de gravité de
l’échiquier politique nippon et de la société, et
de devenir "la religion mondiale", version pseudo-religieuse de l’ONU .
- un parti politique , le
contrôle d’un électorat flottant de6 à 8 millions de
bulletins de vote, le contrôle occulte de parlementaires d’autres
partis.
- l’inflitration bureaucratique
de la Soka Gakkai qui a développé des réseaux secrets
au sein de grands ministères,dans les milieux juridiques, dans la
police des grandes villes, entre autres.
- une infiltration à
l’étranger aussi avec des réseaux secrets dans les
ambassades,les organisations internationales.
- une stratégie de
cour en direction des leaders d’opinion des différents pays,dans
différents domaines politique, culturels, recherche etc..., et une
extrême "générosité" envers nombre de personnalités
piégées ou achetées.
- une stratégie qui
semble, par le biais d’organisations et de mécanismes précis,relever
d’ acti vités de renseignement.
Voilà pourquoi je
parle "d’Etat dans l’Etat". J’ajouterai sur ce thème, quelques chiffres
pour planter le décor.
La Soka Gakkai, c’est
- environ 8 millions
d’adeptes au Japon (sur 123 millions d’habitants), 2 millions à
l’étranger, soit environ 10 millions au total et une présence
dans 128 pays. Ce qui en fait la plus grosse secte du monde.
- un parti politique, le
kômeitô, et le contrôle d’un électorat flottant
de 6 à 8 millions de bulletins de vote.
- une fortune estimée
entre 500 et 700 milliards de francs, ce qui en fait la secte la plus riche
au monde.
- un réseau éducatif,
du jardin d’enfants à l’université, dont certaines structures
sont présentes à l’étranger.
- un parc immobilier impressionnant
- des structures lui permettant
de pénétrer même les milieux les plus fermés.
un statut d’ONG des Nations-Unies, un réseau impressionnant de centres
de recherche, des musées, associations culturelles, etc... Un Etat
dans l’Etat, donc. Ce degré de logistique permet à la Soka
Gakkai de passer au politique, c’est-à-dire de prendre en charge
le politique. C’est une forme de parasitage,dans la mesure où la
majorité des Japonais non membres rejettent cete secte et dénoncent
sa stratégie de pouvoir.
- quand je parle
de "secte d’un type nouveau", une secte géopolitique et planétaire,
je pense qu’il s’agit d’un prototype de ce qui va nous tomber dessus dans
les décennies à venir.
Indépendamment des déterminants
culturels typiquement nippons qui donnent à la Soka Gakkai son originalité,
je crois que lorsqu’une secte a atteint un certain degré de développement
en termes financiers et en termes d’adeptes, les objectifs financiers deviennent
moins pressants et ce qui devient l’objectif primordial est la conquête
du pouvoir. Le dépassement d’un certain degré de logistique
débouche sur un passage au politique, à des fins de conquête
du pouvoir. En cela, la Soka Gakkai, première secte au monde par
sa logistique et le degré de sophistication de sa stratégie,
me semble être le prototype des sectes à venir.
Ce qui signifie également
que les déterminants culturels vont jouer un rôle moins important.
Le Japon apparaît, à tort d’ailleurs, comme un "repoussoir"
, un contre-exemple dont la spécificité culturelle serait
trop particulière pour être exportable.
Or, ces déterminants
culturels nippons n’ont pas fait obstacle à une internationalisation
de la Soka Gakkai. On peut même dire qu’ils ont joué favorablement,et
ceci, d’une façon occulte.
Ce phénomène
est, à mes yeux, l’illustration du passage d’une ère de pouvoir
à une ère d’influence du système international.
BT : La France, au
contraire d’autres Etats, a opté en faveur d’une distinction entre
religion et secte. Est-il possible d’élaborer des critères
permettant de faire une différence entre ces deux types de mouvement
?
FL : On peut en effet
énumérer des caractéristiques permettant de cerner
le caractère sectaire de certaines organisations se prétendant
religions.
Mais avant cela, il faut
rappeler que les Eglises se sont historiquement comportées à
certaines périodes comme des sectes (Inquisition , évangélisation
de certaines populations lointaines comme prélude à la colonisation),
mais ont évolué, sous la pression de certains facteurs internes
et externes, vers une réalité plus proche de l’idéal
religieux. A la limite, l’étalon devrait être normatif, c’est-à-dire
la religion telle qu’elle devrait toujours être.
Le mot secte a eu un sens
historique (branche d’une Eglise faisant sécession suite à
un différend d’ordre doctrinal) qui n’a plus rien à voir
avec la réalité sectaire actuelle.
La secte d’aujourd’hui ne
fait plus sécession sur la base d’un différend doctrinal,
mais en revanche constitue une organisation représentant une nouvelle
version du vieux thème de "l’exploitation de l’homme par l’homme".
Une définition ainsi
que les composantes de la logique sectaire sont exposées et développées
dans le remarquable ouvrage d’Anne Fournier et Michel Monroy "la dérive
sectaire", PUF.Pages 18-23, notamment.
Je reprendrai ces éléments
et insisterai juste sur certains aspects de la réalité sectaire.
- C’est une organisation
hiérarchisée, pyramidale, à tendance totalitaire,
soumise aux diktats non négociables d’un gourou ou d’une bureaucratie
héritière et dépositaire de sa pensée, sorte
de substitut du père.
- avec toute une
gradation dans l’engagement qui va du profil du sympathisant à celui
du fanatique, en passant par l’adepte "total", le cadre convaincu, relais
essentiel dans la chaîne de la manipulation,et l’adepte en proie
au doute.
- cette organisation
diffuse un enseignement exclusif ,c’est-à-dire qui refuse
toute autre interprétation et prétend détenir LA vérité
et donc, auto-référant.Enseignement expansif, parce que cette
interprétation n’est pas limitée à un domaine mais
envahit, peu à peu, tous les domaines de la vie, croyances, sciences,
vie quotidienne, relations avec les autres,etc...aboutissant ainsi à
...
- la construction d’un "isolat
culturel", les relations avec le monde extérieur n’étant
plus appréhendées à travers l’observation objective
des faits et la confrontation émulatrice avec d’autres visions du
monde, mais à travers une grille de lecture codée et artificielle.
Cet "isolat" impliquant une série de ruptures physiques ,ou plus
insidieusement, psychiques avec l’environnement extérieur,diabolisé.
- la secte ( par un mécanisme
d’emprise psychologique qui mêle séduction, culpabilisation,
menace, mobilisation,élitisme) développe une logique "subversive"
(travaux de Marcel Boisot) qui atteint l’identité de l’adepte. L’enjeu,
à travers une modification de l’éthique et de le personnalité
de l’adepte, est en effet l’altération de l’identité par
la construction d’une relation de dépendance qui standardise les
adeptes et les instrumentalise.
- l’objectif est l’acquisition
ou l’exercice d’un pouvoir sur les adeptes et/ou sur la société.
Il faut en effet aborder le problème par les deux bouts. Celui du
gourou qui manipule,celui de l’adepte qui se fait manipuler. Les sectes
ne prolifèrent que dans un contexte sociétal qui y prète
le flanc et qui génère une demande que les sectes viennent
combler en proposant des solutions séduisantes mais fausses
à de vrais problèmes. L’adhésion à une secte
est en fait une marque de refus, de rejet, de révolte à l’égard
de la société, donc la sanction d’un dysfonctionnement sociétal.Cette
insatisfaction est récupérée par la secte qui multiplie
promesses et mirages,tout en masquant les coûts, les contraintes
et les risques, et exploite les angoisses et les peurs.
- enfin , le profil
des groupe sectaires évolue vers un camouflage de plus en plus sophistiqué.
Dans les années 70, mai 68 oblige, les sectes étaient coupées
physiquement du reste de la société et ne cherchaient pas
l’insertion mais le retrait dans des communautés, conformément
à l’idéologie soixante huitarde de l’époque.
Les sectes des années
80-90 et suivantes sont plus pragmatiques. On cherche plutôt à
exploiter la position des adeptes dans la société,à
les instrumentaliser dans le cadre de leur statut social. La rupture est
plus psychique que géographique et plus insidieuse. Ce type
d’exploitation, par ailleurs plus conforme aux contingences économiques
du moment, récupère les aspirations des individus à
se développer dans le cadre de la société et se prête
mieux à une stratégie de pouvoir.D’où la recrudescence
des tentatives d’infiltration des entreprises et organismes de formation,
du monde politique, et de beaucoup de rouages de la société.
BT : Que penser de
la position américaine reconnaissant le statut de religion à
tout groupement. Quels dangers cela peut-il apporter ?
FL : Il y a certes
dans la décision américaine des déterminants
culturels . Dans ce pays de pionniers,de longue date, l’athée est
perçu comme un danger. Mieux vaut croire à n’importe quoi
que de ne pas croire. Tout athée est un communiste en puissance.
D’où la propension
des Etats-Unis à soutenir les mouvements religieux,même les
plus fanatiques. Les "nouvelles religions" sont devenues pour les Etats-Unis
un mode de lutte contre les mouvements populaires sur tous les continents.
Cela nous conduit à des motivations plus sombres et en relation
avec la stratégie de certains services secrets. D’après certains
journalistes d’investigation et certains chercheurs (notamment Bruno
Fouchereau, "la mafia des sectes",éditions filipacchi. Paul Ariès
"le retour du diable" éditions Golias)la majorité des sectes
sont "made in USA". Un bon nombre d’entre elles ont été créées
par des spécialistes de la guerre psychologique pour contrôler
l’espace politique et diffuser la culture nord-américaine. Ces sectes
seraient donc des instruments de diffusion de l’hégémonie
culturelle nord-américaine et entretiendraient des liens intimes
avec les services secrets américains. Le "rapport Rockfeller"de
1969, la "déclaration de Santa Fe" de 1980 illustrent, selon les
auteurs cités, l’utilisation de ces sectes par les services nord-américains
pour la défense des intérêts américains en Amérique
du Sud. Il ne faut pas non plus oublier que le "New Age" est une création
de la côte Ouest américaine et qu’il constitue le terreau
sur lequel prolifèrent les nouveaux mouvements sectaires.
Dès lors, pourquoi
s’étonner de la mansuétude dont fait preuve la Maison Blanche
en faveur des sectes, surtout lorsque l’on sait que certains de ses locataires
ont des liens avec certaines sectes ? Georges Bush avait des liens avec
Moon, ainsi que Hillary Clinton qui est devenue chroniqueuse dans le "Washington
Time" appartenant à Moon. Moon et la Scientologie sont également
réputées avoir financé les coûteuses campagnes
électorales de M. Clinton.
Je confirme, pour ma part,
avoir connaissance des activités de certaines organisations, émanations
de Moon, en Afrique pour le compte de services secrets,ainsi que du recours
par le gouvernement nippon à certaines sectes ou organisations qui
leur sont liées, pour des missions de politique étrangère
ou de négociations économiques dans certains pays étrangers.
Je pense même, au vu
de ces exemples et de mes recherches sur la Soka Gakkai, que le recours
aux sectes comme instruments d’une stratégie de renseignement
est en train de devenir une tendance générale sur la scène
internationale.
Reste à distinguer
les sectes sous contrôle effectif d’un gouvernement, donc instruments
de politique étrangère, et les sectes qui ont dépassé
un niveau de logistique leur permettant de développer leur propre
réseau de renseignement privé et qui s’érigent alors
à la fois en partenaires et compétiteurs de l’Etat, ce qui
me semble être le cas de la Soka Gakkai.
BT : Lorsque vous parliez
de la Soka Gakkai, vous utilisiez l’expression d’Etat dans l’Etat. Est-ce
le cas de l’ensemble des grandes sectes connues ici en France ?
FL : En ce qui concerne
les autres sectes, l’infiltration devient une tendance ,tant dans le monde
économique (entreprises, organismes de formation) que dans le monde
politique.
On peut, par exemple se demander
pourquoi,en France, certains ministères semblent si peu sensibles
à la problématique sectaire... et par qui certains
hommes politiques font financer leurs campagnes électorales ...
Cela étant, de là à constituer des "Etats dans l’Etat",
ce n’est pas encore le cas, pour une question de niveau logistique pour
le moment, mais je pense que c’est une question de temps et que certaines
sectes, lorsqu’elles auront atteint un niveau de logistique à peu
près équivalent à celui de la Soka Gakkai, passeront
au politique. Un parti politique, le contrôle de la longévité
de certains hommes politiques, des réseaux secrets au sein de ministères
ou d’entreprises peuvent constituer une bonne amorce.
Tout cela dépendra
de facteurs internes aux sectes -nombre d’adeptes, capacités financières,
cohésion interne, "sens politique" du gourou, etc ...- mais aussi
de facteurs externes, et notamment d’une prise de conscience du danger
politique, autant que sociétal, que constitue la problématique
sectaire. D’où la lutte des sectes, d’ailleurs, pour obtenir le
label de respectabilté que constitue l’étiquette "nouvelle
religion", avec d’ailleurs le concours de chercheurs et professeurs d’université
financés par ces sectes .
C’est aussi la raison pour
laquelle il me semble nécessaire de ne plus aborder les grandes
sectes sous l’angle de leur action seulement en France,ou dans les milieux
économiques, mais de prendre en compte, ou d’anticiper,la dimension
planétaire et géopolitique de certaines d’entre elles, car
certains aspects sectaires, absents en France, sont présents ailleurs.
Prenons le cas de la Soka
Gakkai. Elle a l’image,hors du sol nippon, d’une organisation qui "donne",
ce qui s’inscrit en contradiction avec l’image traditionnelle de la secte
qui "prend". De fait, si on prend en compte l’activité de la Soka
Gakkai au Japon, on s’aperçoit qu’elle soumet ses adeptes à
un essorage financier méthodique, impitoyable, et périodique.
Elle "prend" au Japon pour "donner" à l’étranger. Les adeptes
nippons financent l’internationalisation de la Soka Gakkai . Par ailleurs,
"donner", c’est aussi dans ce cas "acheter"... Si les dérives
financières sont, dans l’ensemble, discrètes au sein de la
secte en France, c’est parce que, au Japon ,des gens sont spoliés
sans ménagement, et que ces "dons" permettent d’acheter des gens,
de pénétrer des milieux fermés, et de construire
de toutes pièces une image internationale rassurante et légitime.